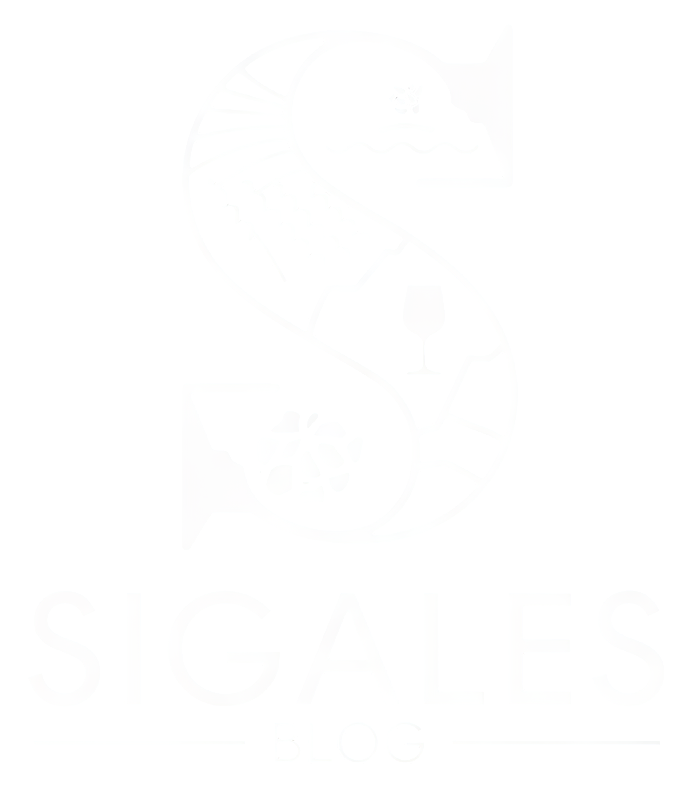Cartographie des influences : Les microclimats méditerranéens au cœur des terroirs du Languedoc-Roussillon
Le Languedoc-Roussillon, plus vaste région viticole de France avec près de 240 000 hectares plantés (FranceAgriMer), est d’abord une terre de contrastes. Entre côte méditerranéenne, garrigue, plaines alluviales, arrière-pays accidenté, et premiers contreforts des...