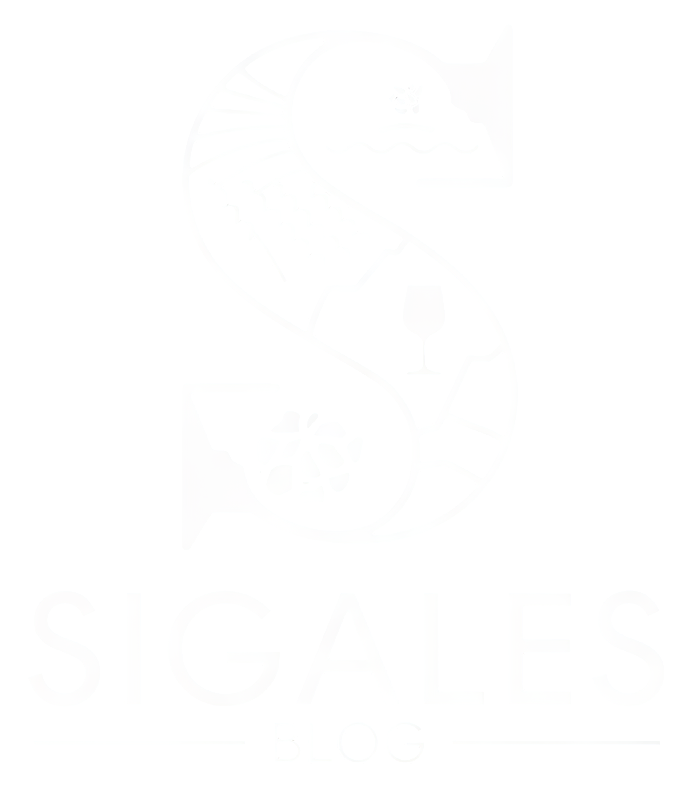Lire le terroir : la cartographie au service des crus bourguignons
Dans le monde du vin, la notion de terroir englobe plusieurs dimensions : le sol, le climat, la topographie, et même la main de l’homme. Les outils de cartographie, notamment les systèmes d’information géographique (SIG), offrent...