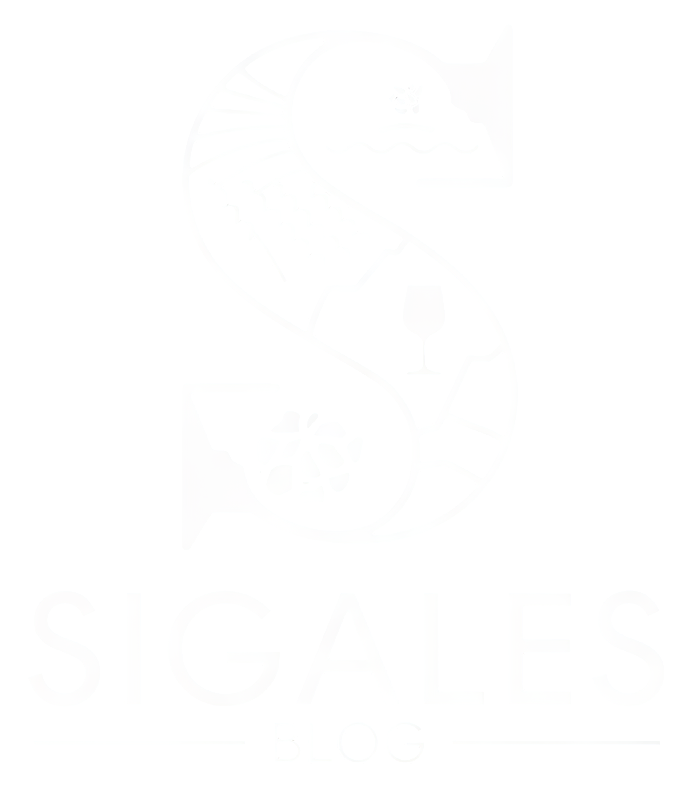Reliefs et vallées : architectes silencieux des terroirs viticoles
Entre le sommet d’un coteau et le lit d’une rivière, le vin trouve d’abord son équilibre dans la forme du paysage. Les terroirs viticoles français, loin d’être de simples parcelles, sont sculptés depuis...