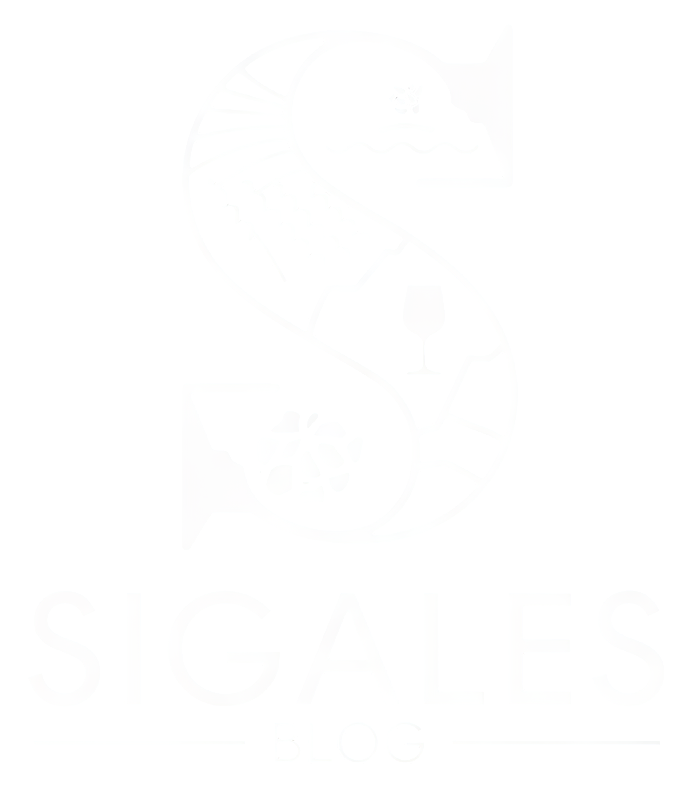Ce qui rend uniques les terroirs viticoles de Bourgogne
Les « climats » de Bourgogne, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015, résument la quintessence du vignoble bourguignon. Le mot « climat » ne désigne pas ici simplement des conditions météorologiques : c’est une division géographique et qualitative...