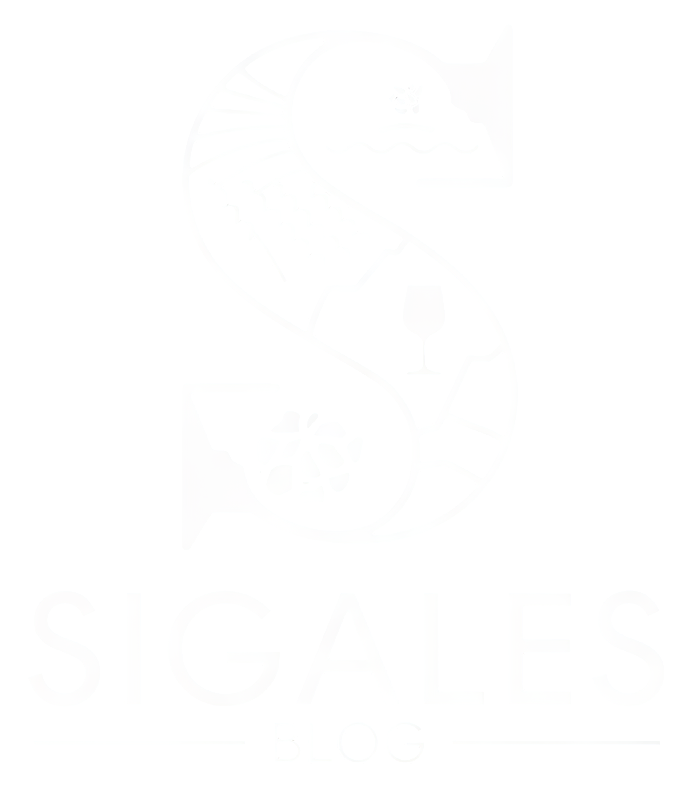Au cœur du Médoc : lecture géographique et viticole des sols graveleux
La presqu’île du Médoc, entre estuaire de la Gironde et océan Atlantique, incarne à elle seule l’articulation subtile du vin et du sol. Bien avant que les vins ne s’imposent comme fers de lance du prestige...