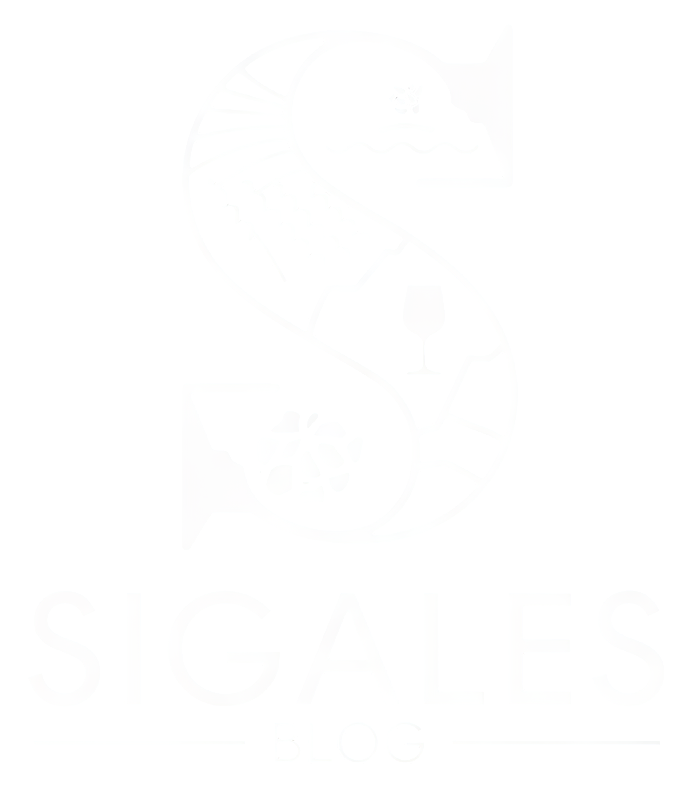L’essence des terroirs bordelais : comprendre la mosaïque viticole d’un vignoble d’exception
Au nord de Bordeaux, le Médoc s’étire entre Atlantique et Gironde. Ici, les graves – galets, graviers, sables mêlés d’argile et parfois d’oxydes de fer – définissent un paysage viticole aussi précieux que fondateur...