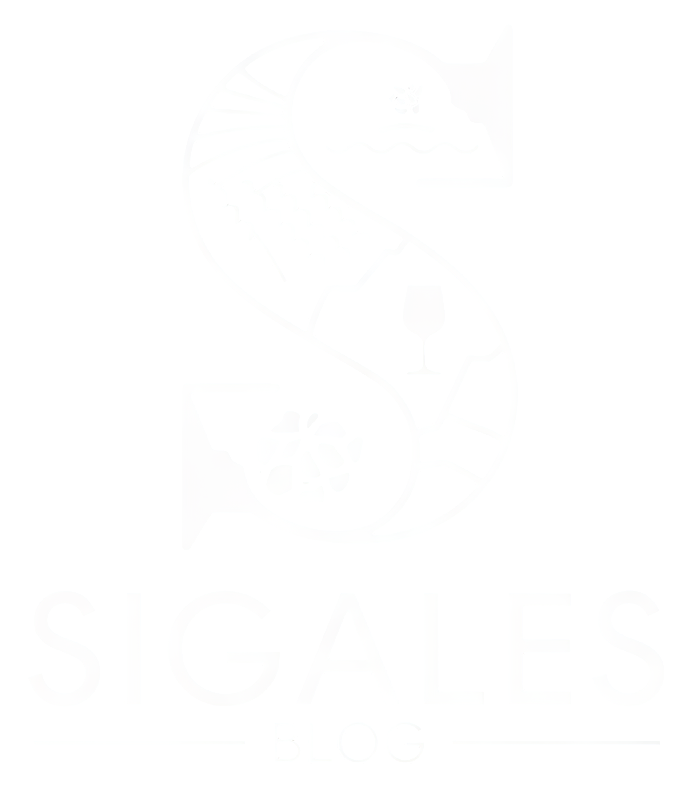La richesse des sols calcaires et marneux explique pour une bonne part la hiérarchisation des appellations en Côte de Beaune. En effet, chaque strate géologique présente des caractéristiques physiques et chimiques qui influencent directement la vigueur de la vigne et la qualité du raisin.
Les calcaires et la finesse des blancs
La Côte de Beaune est mondialement reconnue pour ses grands vins blancs provenant essentiellement du cépage chardonnay. La présence dominante des calcaires jurassiques offre des sols bien drainants, peu fertiles et riches en minéraux comme le calcium et le magnésium. Ce contexte oblige la vigne à plonger profondément ses racines pour puiser l’eau et les nutriments, favorisant ainsi une maturation lente et un équilibre optimal entre acidité et sucrosité.
Ce phénomène s’observe particulièrement dans des appellations comme Puligny-Montrachet ou Meursault, où la finesse et la minéralité des grands crus blancs trouvent une résonance géologique.
Les marnes et la puissance des rouges
Les marnes, avec leur texture plus argileuse, sont idéales pour les cépages rouges comme le pinot noir. Elles retiennent mieux l’eau tout en restituant lentement les nutriments nécessaires à la plante, créant des conditions idéales pour des rouges puissants et complexes. Corton, célèbre pour ses grands vins rouges, illustre ce rapport intime aux marnes jurassiques.
On note également que l’exposition joue ici un rôle crucial. Par exemple, les pentes bien orientées au sud ou au sud-est augmentent la chaleur, favorisant la maturité phénolique des baies et intensifiant les arômes des vins rouges.