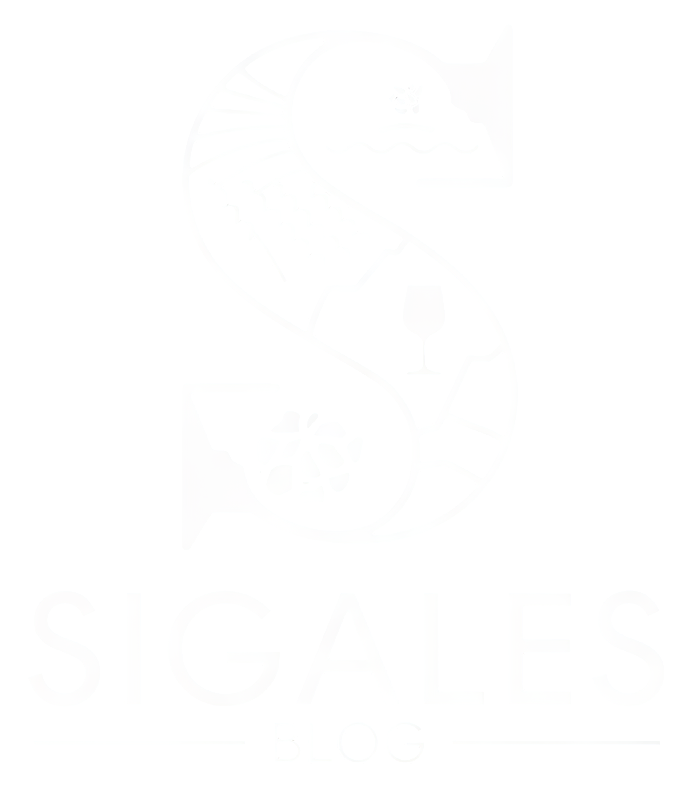Les clés pour comprendre la délimitation des climats de Bourgogne
Le terme « climat » en Bourgogne ne désigne pas la météo, mais une parcelle de vigne minutieusement définie et nommée. Chaque climat se distingue par un terroir unique, façonné par sa géologie, sa topographie...