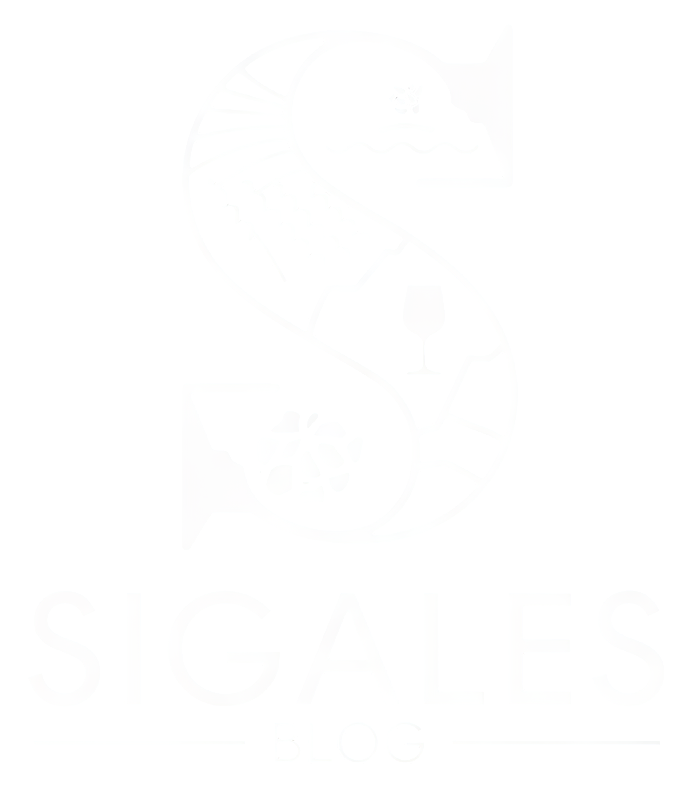Deux cépages dominent largement en Bourgogne : le pinot noir pour les vins rouges et le chardonnay pour les vins blancs. Leur choix s’explique par un mélange d’adaptations historiques, de traditions et, surtout, de contraintes topographiques spécifiques.
Le pinot noir : prospérité en coteaux
Cépage sensible par nature, le pinot noir préfère les sols drainants et les expositions favorables. Les coteaux bourguignons, avec leurs pentes modérées (généralement entre 10 et 20 %) et leurs orientations sud-est, répondent parfaitement à ces exigences. Ces reliefs permettent d’éviter les gelées tardives grâce à une meilleure évacuation des masses d’air froid. Par ailleurs, ils assurent une maturité optimale des raisins grâce à une exposition prolongée au soleil, mais sans excès, ce qui préserve l'équilibre aromatique et l'acidité véhiculée par les sols calcaires.
La côte de Nuits, célèbre pour ses grands crus tels que Romanée-Conti ou Chambertin, illustre bien l’influence de la topographie sur le pinot noir. Ici, il est majoritairement planté sur les pentes moyennes, entre 250 et 300 mètres d’altitude, là où l’interaction entre exposition et drainage produit des vins à la fois puissants et subtils.
Le chardonnay : roi des sols basaltiques et calcaires
Le chardonnay, moins capricieux que le pinot noir mais tout aussi exigeant, s’épanouit différemment selon les topographies. Sur les reliefs de la côte de Beaune, ce cépage privilégie des pentes douces et une exposition légèrement moins directe que le pinot noir. La raison en est simple : en Bourgogne, le chardonnay prospère sur des sols argilo-calcaires, particulièrement riches grâce à l'érosion des pentes. Le drainage modéré des sols est en revanche essentiel pour éviter une dilution excessive.
Les grands crus tels que Montrachet ou Meursault sont emblématiques de cette équation entre topographie et cépage. Situés à des altitudes comprises entre 240 et 280 mètres, ces vignobles tirent leur singularité d’une exposition savamment dosée, permettant une maturation lente et régulière des raisins.